Interview de Mylène BLASCO Revue Hypnose et Thérapies Brèves 77

PROPOS RECUEILLIS PAR GÉRARD OSTERMANN
Le langage devient le lieu d’un échange où se joue l’équilibre entre savoir scientifique et humanité.
Un grand merci à Mylène Blasco, qui nous a accordé cet entretien, destiné à faire connaître sa dernière publication, du plus grand intérêt pour tous les lecteurs et lectrices de la revue « Hypnose & Thérapies brèves ». L’ouvrage Langage, langue, parole dans la relation de soin (1) dirigé par Mylène Blasco, professeure en sciences du langage à l’université Clermont-Auvergne, explore la dynamique des échanges verbaux entre soignants et patients. Ce travail de réflexion et d’analyses linguistiques est mené par une équipe interdisciplinaire composée de linguistes, sociologues, médecins et psychanalystes.
Ce livre vise à :
analyser la place de la langue et le poids de la parole dans le soin ;
sensibiliser les soignants à une écoute attentive du patient ;
encourager une utilisation plus consciente et précise de la langue dans les consultations.
La relation de soins, qu’elle se déploie dans un cadre médical, psychologique ou social, repose sur bien plus que les compétences techniques. Au cœur de cette relation se trouve un élément intangible mais fondamental : le langage. Les mots que l’on choisit, leur insertion dans des phrases, les silences que l’on respecte, les tonalités que l’on adopte façonnent l’expérience du soin autant que les gestes techniques ou les traitements administrés. La langue utilisée devient ici un outil, une médiation, et parfois un soin en lui-même. Le langage n’est plus un simple outil de communication : il construit des significations, apaise les angoisses et instaure un cadre rassurant. En situation de soins, il offre une compréhension du diagnostic, une explication des traitements ou une mise en perspective de l’avenir.
Mylène Blasco, comment est venue l’idée de cette recherche pluridisciplinaire, qui m’apparaît comme un travail titanesque ? Mylène Blasco :
Je tiens à préciser que cet ouvrage est la suite d’un premier livre (2), qui résultait d’un projet de recherche inter-universitaire démarré en 2016. Ce projet inno vant faisait collaborer des cliniciens et des chercheurs en sciences humaines. Des médecins de services hospitaliers avaient demandé que des psychanalystes viennent parler, dans leurs services, avec des patients pendant une heure. Il s’agissait de voir ce que les patients pouvaient dire à un psychanalyste et qu’ils ne disaient pas en consultation. Tu avais d’ailleurs participé à ce travail. Les linguistes ont entrepris leur travail de linguiste, avec leurs méthodologies, sur les données verbales recueillies à l’hôpital lors de consultations médicales et de présentations cliniques. Le corpus oral a été constitué de manière très rigoureuse.
C’est un travail titanesque, parce qu’on enregistre en situation réelle et on retranscrit fidèlement tout ce qui est dit. C’est indispensable pour saisir la langue telle qu’elle est dans sa matérialité. Ensuite on a fait des analyses linguistiques des données pour essayer justement de comprendre quelle serait la spécificité du langage des patients et des médecins dans ces échanges. Progressivement, on a constaté qu’on avait du mal à communiquer avec les médecins parce que nos analyses étaient trop techniques et qu’il fallait mettre en lien les résultats de nos recherches avec les préoccupations des médecins. L’objectif du deuxième livre à été de travailler ensemble, avec le point de vue des médecins, sur la représentation de la langue, sur la manière dont elle est utilisée et sur la portée des formes linguistiques choisies dans le discours. Dans ce livre, il y a des médecins spécialisés, il y a des médecins psychanalystes, et donc on a travaillé avec eux pour voir à quel moment on se rejoignait, dans nos questionnements et avec nos constats. Le langage et la langue utilisés ont un impact dans la communication, par exemple le patient ne se sent pas compris ou il ne se sent pas écouté. L’écoute du médecin, même attentive, peut quelquefois passer à côté de ce qui se dit vraiment. On a essayé de montrer que le hiatus, dans cette communication particulière, relevait de la différence des rôles sociaux, des attentes, des objectifs, des représentations que chacun se faisait de l’événement.
Quelles ont été les conclusions du premier ouvrage ?
La conclusion est que l’écoute dite active du médecin est bien sûr présente, alors même que cette dernière rencontre des contraintes comme le temps imparti à la consultation. Mais les faits de langue observés montrent qu’il faut distinguer ce qui est dit et ce qui se dit vraiment. Cela résulte de la posture des interactants : le médecin questionne, cherche à comprendre, diagnostique ; le patient raconte une expérience, exprime des ressentis. Ainsi, il y a des informations que le médecin sélectionne ou n’entend pas dans le discours du patient, et le patient pourrait entendre des choses qui ne sont pas dites. Sur ce point nous étions tous d’accord pour parler de la complexité du langage. La conclusion était qu’à travers certains faits de langue très spécifiques, par exemple l’emploi du « je + verbe », comme « je chute », dominant chez le patient, alors que le médecin utilise des noms comme « chute » ou des questions sans verbe de type « pas de tabac ? », sans adresse directe au patient (de type « vous fumez ? »). Ces formes syntaxiques apportent des informations sur par exemple la manière dont le patient pourrait se sentir effacé dans le discours du médecin. En effet, la nominalisation (vs l’emploi de verbes) est importante, quand on connaît bien le fonctionnement du français parlé. Elle apparaît dans des discours plutôt techniques, professionnels, et tend à dépersonnaliser le discours. C’est pour ça que l’approche descriptive de la langue est importante. Ceci montre que dans la matérialité du langage il y a des choses à repérer pour que le médecin, après, puisse être attentif et s’en servir.
Tu peux nous donner un autre exemple ?
Si on s’intéresse aux verbes utilisés par le médecin, on peut s’apercevoir que celui-ci demande davantage au patient de lui « expliquer » que de lui « dire », ou de lui « raconter » plutôt que de lui expliquer. En revanche, le médecin emploie ce verbe quand il s’adresse au patient : « je vais vous expliquer ». Ajouté à d’autres éléments de langage, on peut penser, à travers ces emplois et ces répartitions, que le médecin distribue les rôles dans l’interaction, et garde, si on peut dire, un rôle dominant. Dans la communication, la posture professionnelle du médecin (qui se vérifie dans sa manière de parler) pourrait renforcer le sentiment du patient de ne pas être reconnu en tant que sujet, entendu dans sa singularité. Notre connaissance de la langue parlée nous amène donc à remarquer les faits de langue peu ordinaires ou répartis d’une manière particulière pour en tirer une interprétation pragmatico-sémantique.
Un dernier constat est que la langue du médecin pour le lexique mais aussi pour la grammaire de la phrase est une langue hybride, à la fois spécialisée, et ordinaire. Ainsi se pose la question de la conscientisation de la langue. Est-ce que le passage d’une langue à une autre ne risque pas de brouiller le message ? Médecins et patients n’utilisent pas les mêmes mots ou les emploient différemment : par exemple, quand le médecin parle de « poids », le patient parle de « kilos ». Les analyses linguistiques encouragent à se poser la question du choix des mots et de ce que ce choix dit du ressenti du patient lors de l’entretien.
Mylène, les mots sont plus que de simples outils de communication, dans la mesure où ils construisent des significations, ils apaisent les angoisses et ils instaurent un cadre rassurant...
Oui, en effet, le langage est un objet complexe, il faut distinguer ce qui est dit de ce qui se dit. Mais il n’y a pas que les mots. C’est là où le savoir-faire du linguiste est important. Au-delà des mots, ce sont les structures grammaticales : le fait d’employer des verbes et en particulier certains verbes, le fait d’employer des noms plutôt que des formes verbales avec un sujet, le fait d’interagir avec l’autre sans partager les structures syntaxiques. Nous travaillons sur la grammaire de la langue, sur la manière dont les mots s’organisent. Et c’est ça qui est novateur et complémentaire des études conduites sur la communication médecin-patient, sur la langue médicale, sur les langues dites spécialisées.
Oui, ça c’est en effet très novateur. Parce que bon, on peut dire aussi que, par exemple, des mots maladroits ou trop techniques, dépourvus de flexibilité, vont accentuer le sentiment d’angoisse ou d’incompréhension ou d’isolement...
Oui, mais ça, tu vois...
Mylène Blasco
Professeure en sciences du langage à l’université ClermontAuvergne. Elle a assuré la responsabilité scientifique du projet DECLICS (Dispositif d’Etudes Cliniques sur les Corpus Santé) et est responsable, depuis 2019, du Diplôme inter-universitaire (DIU) sur les relations médecins-soignants/patients à l’université Clermont-Auvergne.
Gérard Ostermann
Professeur de thérapeutique, médecine interne, psychothérapeute. Administrateur de la Société française d’alcoologie, responsable du diplôme d’université de Pathologie de l’oralité, Bordeaux 2.
NOTES
1. Rubrique « Livres en bouche », Revue « Hypnose & Thérapies brèves » n° 75, novembre/décembre 2024/janvier 2025, p. 122
2. Blasco M., « Parler à l’hôpital. Ecouter ce qui est dit, décrypter ce qui se dit », Münster. Nodus Publikationen, 2022.
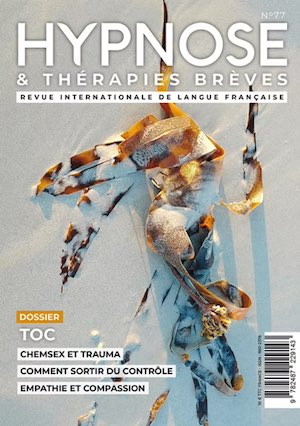 N°77 : Mai / Juin / Juillet 2025
N°77 : Mai / Juin / Juillet 2025
Julien Betbèze, rédacteur en chef, nous présente ce numéro :
Editorial : « L’empathie et la compassion comme fil d’or du soin » Julien Betbèze
8 / En couverture : Anne Dayot De sable et d’algues Sophie Cohen
10 / Désamorcer les traumas et se replacer dans l’existence par la Psychothérapie du Trauma Réassociative (PTR) Marine Manouvrier et Gérald Brassine
20 / Chemsex, trauma et EMDR-IMO . L’échelle de mesure « croire en moi » Sophie Tournouër
28 / Cothérapie avec Romain Faire émerger les relations sécures Jérémie Roos
36 / La voie métaphorique en « super-inter-vision ». Comment développer la créativité. des soignants Claire Conte-Rossin et Catherine Martin
ESPACE DOULEUR DOUCEUR
46 / Introduction Gérard Ostermann
50 / Empathie et compassion Deux forces pour soigner autrement Olivier de Palézieux
61 / INTERVIEW Mylène Blasco Propos recueillis par Gérard Ostermann
68 / DOSSIER TOC
70 / La société contemporaine : Perfection et fabrique des TOC Grégoire Vitry et Emmanuelle Gallin
82 / La pensée magique dans les TOC Typologie des rituels magiques Claude Michel
QUIPROQUO
98 / Les obsessions S. Colombo, Muhuc
BONJOUR ET APRÈS...
102 / André et son ventre Pour une séance plus qu’émouvante Sophie Cohen
LES CHAMPS DU POSSIBLE
106 / Se cogner au réel Adrian Chaboche
CULTURE MONDE
114 / Dans les sanctuaires du shintō Bruno Bréchemier
LIVRES EN BOUCHE
120 / J. Betbèze et S. Cohen
125 ESPACE FORMATIONS
Illustrations: Anne DAYOT
- Thérapies et Médecines Complémentaires
- Revue Hypnose et Thérapies Brèves
- Affichages : 427

